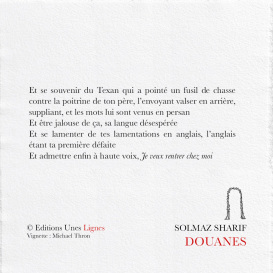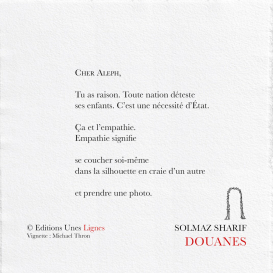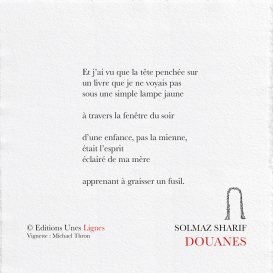Douanes
Les douanes sont ces lieux qui n’en sont pas, des lieux où l’on vous demande d’où vous venez, qui vous êtes, ce que vous faites. Ou ce que vous venez faire ici. Solmaz Sharif semble écrire à partir de l’impossibilité de répondre à ces questions. Elle écrit à partir de la difficulté de ce passage des frontières, d’un territoire à un autre, de la mémoire au présent, d’une identité à l’exil. Dans Mire, son extraordinaire premier livre, Sharif se servait des termes du dictionnaire militaire américain pour évoquer la violence de l’État, la violation de l’intimité et les guerres impérialistes. Plus de dictionnaire ici, mais un apprentissage solitaire d’un langage perdu. Seule face à ses origines perdues, irrattrapables, passagère en sursis dans la grande caravane de l’Occident, Sharif interroge ses racines iraniennes, qui ne sont que des racines inconnues, des souvenirs imaginés, un passé recomposé. Elle est « d’ailleurs », que ce soit à Shiraz, la ville de ses parents, ou en Californie, où elle vit. Un ailleurs qu’elle a malgré elle « appris à être ». Solmaz Sharif revendique une poésie politique – ne dit-elle pas dans un poème que « toute nation déteste ses enfants » ? – et une position de femme considérée comme une barbare dans un pays de colons. Passer une frontière est acquis pour les uns, impossible ou douloureux pour les autres, confinés derrière les barrières. « Visa » vient de « voir » nous dit-elle, et c’est ce regard qu’elle démultiplie tout au long de ces Douanes : l’œil noir des caméras de surveillance, le regard d’un amant sur son corps nu ou celui des policiers quand elle se déshabille, les souvenirs dans le rétroviseur, les prisonniers politiques à la télévision, tout ce que notre origine sociale ou ethnique nous autorise à voir, ou nous oblige à imaginer. À rebours de cette Amérique de synthèse droguée aux produits dévitalisés, à la richesse monétaire et au voyeurisme, Sharif retrace les rites anciens de ses ancêtres, et opère, à l’image des anciens tanneurs chassés en périphérie des villes à cause de la puanteur et qui décharnaient les peaux des bêtes pour produire du cuir, une forme de desquamation du poème, qui détache la chair émotionnelle de l’os de son identité. Comme ses ancêtres elle fabrique avec des mots des seaux de cuir qu’elle plonge dans le puits du passé pour en faire remonter un « reflet » de soi-même. Elle retourne chercher tout ce qu’elle avait soustrait d’elle faute de pouvoir « supporter de le regarder ». L’exil peut-il prendre fin, lui qui vous touche jusque dans votre intimité, dans votre refus d’être touché, tant il vous habitue à « perdre même la perte », tant tout retour est impossible quand on vient de « nulle part » ? Solmaz Sharif raconte le passage, le franchissement, une identité en quête de paysage, des cyprès, un chemin de pierres, un signe de la main.
2023, traduit de l'anglais (États-Unis) par Raluca Maria Hanea et François Heusbourg
104 p., format 15 x 21 cm, broché cousu, ISBN 978-2-87704-267-3, 19 €
Vignette de couverture : Michael Thron
Imprimé en France